Comment les anciens Egyptiens ont-ils fait pour ériger un monument tel que la Grande Pyramide en seulement vingt ans ? Depuis quelques années une hypothèse captivante était à vérifier: et si les Pyramides de Gizeh n’étaient pas faites en pierres de taille, mais en pierre artificielle? Dès 1979, un scientifique français, Joseph Davidovits, a cherché à démontrer cette possibilité. Il en résulte selon lui, que les gigantesques blocs qui forment les assises des pyramides auraient tout simplement été modelé sur place à l’aide d’une pâte fluide composée de calcaire, d’argile et de natron agglomérés durcissant en quelques jours, à la manière du béton. En tant que chimiste, spécialiste des géopolymères, il est parvenu à en reconstituer. Deux articles qui viennent d’être publier, l’un dans la revue Science & Vie, et l’autre dans le Journal of the American Ceramic Society apportent un nouveau crédit à cette hypothèse. Dans ces études, des échantillons de calcaire provenant des carrières proches des pyramides et d’autres provenant des pyramides ont été analysés et comparés. Ils ont montrés une différence dans leur structure. Le matériel des pyramides contient en particulier une espèce de liant absent du matériel naturel.
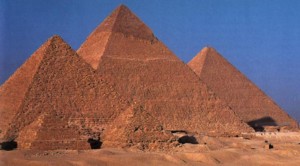
Les pyramides du plateau de Gizeh
On sait depuis longtemps que l’Antiquité connaissait le béton. La maitrise technique du mélange composé en partie de pouzzolane avait permis aux Romains d’édifier de gigantesques et splendides bâtiments comme les thermes de Caracalla ou de Dioclétien. Mais rien de tel n’était attesté chez les Egyptiens. Si l’usage du béton est démontré chez les anciens Egyptiens, cela permettrait d’expliquer plus facilement comment ils sont parvenus à ériger un monument tel que la Grande Pyramide en seulement deux décennies. Ainsi, le matériel nécessaire à la construction fut amené non sur des traîneaux, mais dans de simples paniers et versé dans des coffrages directement sur le monument. Cette manière de faire permet de répondre à de nombreuses questions qui jusqu’à présent posaient problème comme celui du transport et de la mise en place des pierres à plus d’une centaine de mètres de hauteur et de l’ajustement aussi parfait, au sein de la structure, de bloc pesant plusieurs tonnes. Si cette hypothèse se confirme, une partie du mystère de la Grande Pyramide, notamment celui de sa construction, serait ainsi levé. Une fois cette technique mise au point on a de la peine à imaginer qu’une telle pratique ait pu être oubliée sans suite et n’ait pas été mise en œuvre pour d’autres constructions, en particulier celles des temples. La recherche ne fait donc que commencer. Malheureusement, il semble que les autorités égyptiennes ne soient pas très enclines à faciliter le travail des scientifiques et à permettre des analyses sur les monuments afin de vérifier l’hypothèse à partir d’échantillons prélevés dans les règles de l’art. On se demande bien pourquoi.
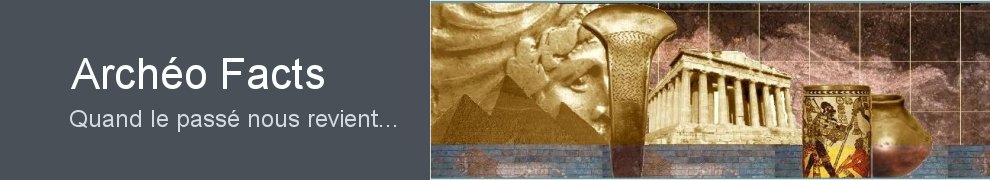
One Response to Des pyramides en béton?